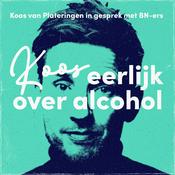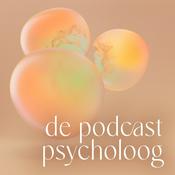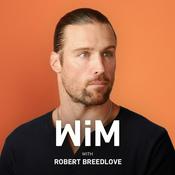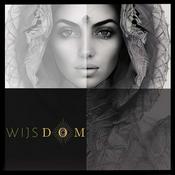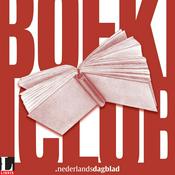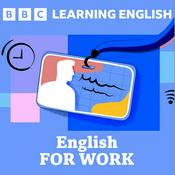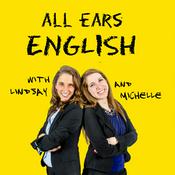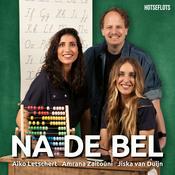313 afleveringen
- C’est un invité exceptionnel que nous recevons aujourd’hui à l’ISP en la personne d’Yves Saint-Geours.
Yves Saint-Geours bonjour. Les mots manquent pour décrire votre parcours. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur et actuel président du Conseil d’administration de l’institut pasteur. Emmanuel Macron vous a par ailleurs nommé l’année dernière co-président de la commission franco-haïtienne sur la double dette haïtienne.
Tout au long de votre parcours, qui a débuté dans l’enseignement, vous avez multiplié les expériences jusqu’à acquérir une connaissance unique du fonctionnement de l’Etat.
Vous avez notamment été conseiller au cabinet de deux ministres des affaires étrangères, mais aussi ambassadeur en Bulgarie, au Brésil et en Espagne. Vous avez également présidé l’établissement public du Grand Palais des Champs-Elysées. Agrégé d’histoire et diplômé d’études approfondies ibériques et ibéro-américaines, vous êtes par ailleurs un fin connaisseur de l’Amérique latine. Vous avez notamment écrit « La vie quotidienne en Amérique du Sud au temps de Bolivar : 1809-1830 » chez Hachette, ainsi que « L'Amérique latine de l'Indépendance à nos jours », chez PUF.
Cependant, c’est une autre de vos multiples casquettes qui nous vaut de vous recevoir aujourd’hui.
En effet, vous connaissez bien le monde judiciaire puisque vous avez été désigné par le président de la République comme membre du Conseil supérieur de la magistrature, fonction que vous avez exercée entre 2019 et 2022. Pendant quatre années, vous avez donc participé à la nomination des plus hauts magistrats du monde judiciaire, sillonné la France pour aller à la rencontre des juges et procureurs dans leurs tribunaux, participé activement à la déontologie et à la discipline des magistrats et surtout – car il s’agit de la mission première du Conseil – assisté le président de la République dans la préservation de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Encore, un autre point de votre parcours hors norme nous intéresse particulièrement et intéressera tout particulièrement ceux de nos auditeurs qui passent les concours. En effet, à l’issue de votre passage au CSM, vous avez été pendant plusieurs années le référent de l’épreuve de connaissance et compréhension du monde contemporain du concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la magistrature.
Dit plus prosaïquement, la dissertation de culture générale du concours de l’ENM, c’est vous ! Vous êtes la personne qui se cache notamment derrière le sujet de 2023 « être citoyenne et citoyen aujourd’hui » et celui de 2025 « Les océans et les mers ».
Yves Saint-Geours, nous avons mille questions à vous poser, en vous remerciant tout d’abord à nouveau d’avoir accepté de répondre à l’invitation de l’ISP. - Le droit de vote est une exigence démocratique, mais comment les électeurs sont-ils représentés ? Quels sont les différents modes de scrutin, leurs avantages et inconvénients ?
Dans le scrutin proportionnel, les sièges sont répartis en proportion du nombre de voix obtenus par chaque liste, alors que dans le scrutin majoritaire la liste en tête remporte tous les sièges.
Par principe, le débat sur le mode de scrutin se focalise sur les élections législatives. Mais il concerne aussi les autres scrutins : aux élections municipales c'est un scrutin mixte, proportionnel avec une prime majoritaire, qui prévaut depuis les élections de 1973 ; aux élections régionales, après la proportionnelle intégrale à partir de 1986, une prime majoritaire s'applique depuis le scrutin de 2004.
Si la proportionnelle a toujours prévalu aux européennes, elle ne s'est pas toujours exercée dans le cadre d'une unique circonscription nationale. Quant aux départementales, le scrutin est certes majoritaire, mais pour élire non plus un mais deux candidats (un homme et une femme, parité oblige) depuis 2015...
Bref, en matière de mode de scrutin, les multiples objectifs poursuivis (représentation des minorités, majorités stables) se traduisent par des évolutions particulièrement fréquentes, et tout particulièrement en France.
Comment caractériser ces différents modes de scrutin ? Quelle est leur utilisation en France ? Parviennent-ils à concilier l’idéale représentation des différents courants d'opinion et la nécessaire stabilité gouvernementale ? et donc on connaît la fragilité ou le caractère désormais utopique.
Pour traiter ces différentes questions et revenir une nouvelle fois sur un sujet donné dans le cadre des grands oraux des concours, je reçois aujourd'hui Benoît Quennedey, enseignant de droit public et de culture générale à la Prépa ISP. Le rôle de l'Etat et du droit dans la lutte contre les défaillances des entreprises
04-2-2026 | 55 Min.Longtemps le failli a été considéré comme indigne, indigne de poursuivre une activité commerciale.
Ce temps est révolu, non seulement les défaillances d’entreprises ne sont plus honnies, sauf banqueroute, mais en sus notre économie prend en charge ces défaillances pour en limiter les effets sur l’entreprise en difficulté, ses salariés, ses partenaires et clients, voire sur la société en général.
Ici, le droit devient un vecteur de l’économie et de la politique.
Derrière ce mouvement, se dessine une idée portée par l’économie libérale de marché mais aussi une facette de l’état providence.
L'Etat veille et doit veiller à la "santé des entreprises" parce que la santé des entreprises est souvent synonyme de santé de l’économie française en général. Un constat qui se fait dans des temps exceptionnels comme pendant l’état d’urgence sanitaire instauré en raison de l’épidémie de Covid-19, mais aussi dans des temps plus communs, comme présentement.
Constamment, l’on ambitionne d’améliorer la prise en charge des défaillances d’entreprises par le droit et l’Etat. Les réformes législatives se multiplient sans satisfaire.
Pour envisager donc la difficile question du rôle du droit et de l'État dans la lutte contre les défaillances des entreprises, j’ai le plaisir de recevoir Jacob BERREBI, l’habituel animateur des podcasts de l’ISP, qui pour une fois sera l’interviewé.- En 2023, les tribunaux administratifs fêtaient leurs 70 ans d'existence.
En 2029, le Conseil d’Etat fêtera les 230 ans de sa création depuis qu’il a été créé en 1799 par Napoléon Bonaparte.
Que d’évolutions depuis lors !
Le magistrat de l’ordre judiciaire est un personnage connu du monde du droit et au-delà. Nous le connaissons bien au sein de la Prépa ISP évidemment.
Mais le rôle, les missions, les compétences et les pratiques du juge administratif nous sont moins familiers, malgré l’importance prise en droit français par le droit public, et par celui qui en est le premier artisan.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous proposer ce podcast sur l’office du juge administratif et ses évolutions récentes.
Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Michaël Poyet, magistrat administratif, et auteur d’ouvrages en droit administratif et en procédure administrative contentieuse et modes amiables de résolution des différends, édités chez Lextenso-LGDJ, et enseignant dans ces matières au sein de la Prépa ISP. - Quel point commun existe-t-il entre François Barbé-Marbois, Pierre Joxe, Philippe Seguin, Didier Migaud ou encore Pierre Moscovici ? Tous ont occupé les fonctions de Premier Président de la Cour des comptes.
Une institution traditionnellement considérée comme essentielle bien que le plus souvent méconnue du grand public, si ce n’est des juristes et économistes eux-mêmes.
Son rôle, ses compétences et pouvoirs, il est vrai, ne sont connus que de certains spécialistes, de quelques connaisseurs des sciences politiques et des acteurs de l’Etat.
Pourtant, régulièrement, l’on cite dans les médias et le discours politique le rapport annuel de la Cour des comptes, souvent pour dénoncer l’utilisation, la mauvaise utilisation des deniers de l’Etat et l’état pathologique de nos finances publiques.
Dans le débat public, ses détracteurs sont plus nombreux que ses admirateurs. La Cour des comptes serait une institution qualifiée de poussiéreuse ; ses recommandations seraient sans effets. Elle ne serait qu’un instrument politique, une antichambre destinée à préparer et justifier en amont les réformes du Gouvernement. Sa partialité serait connue, comme son absence d’indépendance nuirait à son objectivité.
Face à cette opinion commune, la question de l’utilité de la Cour des comptes peut légitimement se poser notamment dans ce contexte budgétaire actuel particulièrement dégradé que nous avons déjà évoqué.
Pour aborder la question nous accueillons Vincent Mazzocchi, Avocat inscrit au Barreau de Paris, Docteur en droit public et intervenant au sein de la Prépa ISP.
Meer Onderwijs podcasts
Trending Onderwijs -podcasts
Over Les podcasts de l'ISP
ISP - Prépa d'excellence aux concours juridiques et administratifs : ENM ; CRFPA ; police ; DGSE ; douanes ; DSGJ ; greffiers ; pénitentiaire ; pjj ; Commissaire de justice ; Haute Fonction publique.
Podcast websiteLuister naar Les podcasts de l'ISP, Dai Carter: Missie Mentale Kracht en vele andere podcasts van over de hele wereld met de radio.net-app

Ontvang de gratis radio.net app
- Zenders en podcasts om te bookmarken
- Streamen via Wi-Fi of Bluetooth
- Ondersteunt Carplay & Android Auto
- Veel andere app-functies
Ontvang de gratis radio.net app
- Zenders en podcasts om te bookmarken
- Streamen via Wi-Fi of Bluetooth
- Ondersteunt Carplay & Android Auto
- Veel andere app-functies


Les podcasts de l'ISP
Scan de code,
download de app,
luisteren.
download de app,
luisteren.